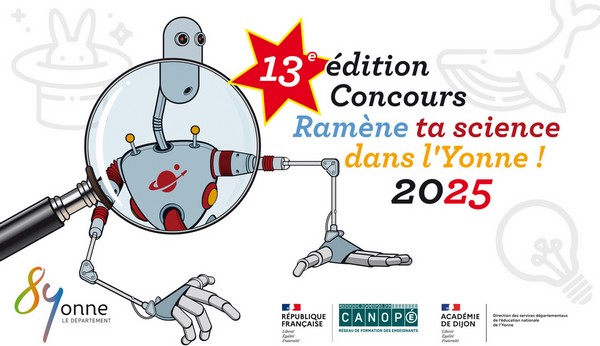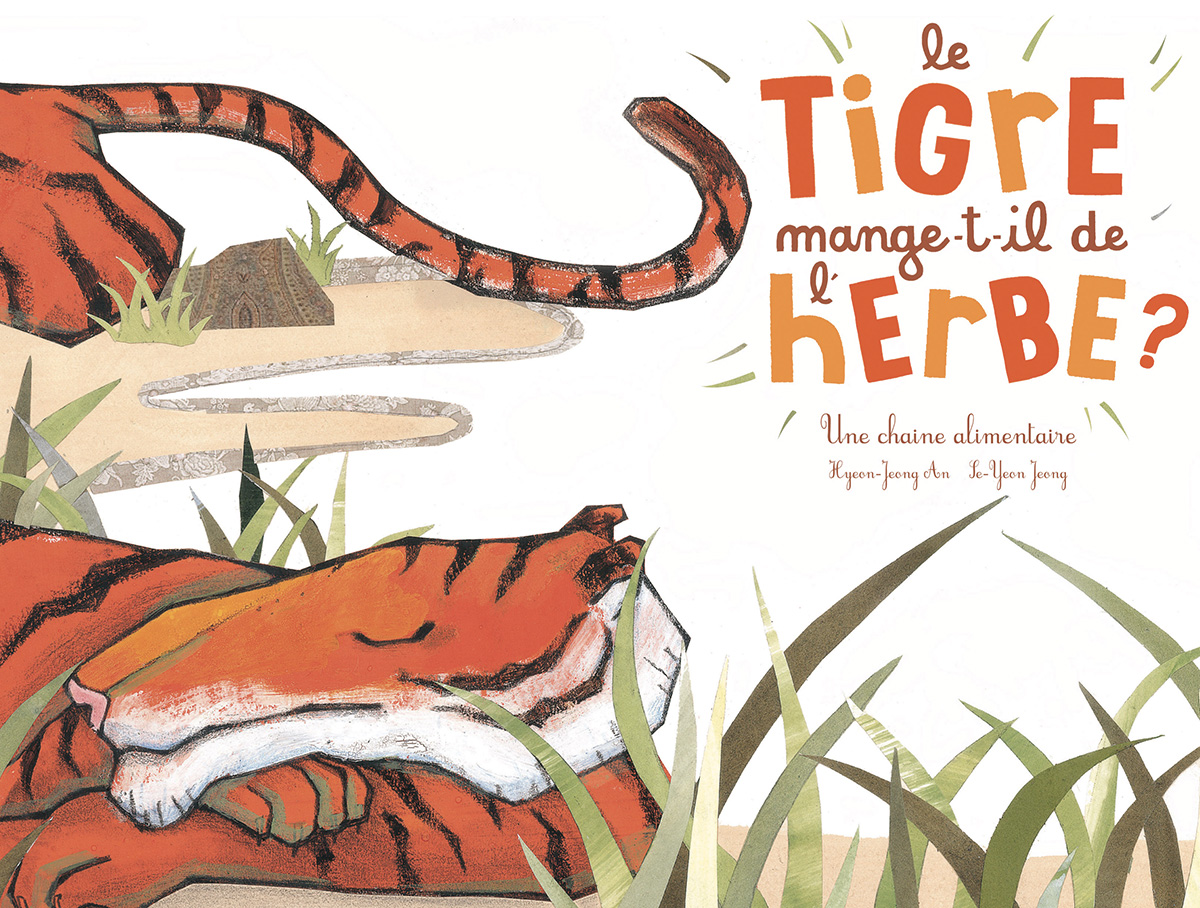13ème édition « Ramène ta Science » dans l’YONNE ! 2025
Dossier de présentation téléchargeable ∇
-
Défi 1 - Sciences et magie : à vous de nous jouer des tours !
-
Défi 2 - Les océans : une plongée dans la science
-
Défi 3 – Sujet libre
RÈGLEMENT
CONCOURS OUVERT À TOUTES LES DISCIPLINES
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
• Article 1 • ORGANISATEURS DU CONCOURS
Le Département de l’Yonne organise, en partenariat avec l’Éducation nationale et l’Atelier Canopé, un concours scientifique destiné aux élèves des collèges du département de l’Yonne appelé « Ramène ta science dans l’Yonne ! ».
• Article 2 • OBJECTIFS DU CONCOURS
Le concours « Ramène ta science dans l’Yonne ! » a pour objectif de donner la possibilité aux élèves de s’impliquer collectivement dans un projet de réalisation scientifique et / ou technologique :
• qui suscitera leur curiosité et les motivera dans leurs apprentissages,
• qui donnera ainsi une image positive de l’enseignement des sciences et de la recherche,
• qui les placera au cœur de leurs apprentissages et développera leur culture scientifique.
• Article 3 • PUBLIC CONCERNÉ
Ce concours est ouvert à tous les collèges du département de l’Yonne.
Il s’adresse aux classes de 6e, 5e, 4e, 3e, ou aux groupes d’élèves volontaires encadrés par leurs professeurs dans le cadre de : tout enseignement disciplinaire ou interdisciplinaire, clubs ou ateliers scientifiques, accompagnement éducatif, toute autre structure du collège.
Le jour de la finale, le projet sera présenté au jury par une équipe limitée à 5 élèves maximum. Néanmoins, si d’autres élèves y ont collaboré, ils seront également invités à participer à cette journée pour soutenir leurs camarades et profiter de tous les autres évènements programmés.
À noter : pour des raisons liées au transport et à la capacité d’accueil de la salle, le groupe ne pourra pas excéder 12 élèves, au total, par projet.
Le nombre de projets présentés au concours est limité à quatre par établissement.
Les partenariats sont possibles avec d’autres disciplines enseignées au collège et/ou avec des structures externes à l’établissement (chercheurs, entreprises, etc.). Cependant, il s’agit avant tout d’un concours scientifique et technologique, c’est donc dans ces domaines principalement que les projets seront évalués.
Les productions doivent émaner d’un cadre strictement scolaire et être le reflet de créations d’élèves.
• Article 4 • LE DÉFI
Chaque groupe participant devra imaginer et concevoir un dispositif expérimental (ou une modélisation) répondant à l’un des défis proposés ou à un choix d’investigation personnel en optant pour le sujet dit “sujet libre”.
La fiche de candidature (une par projet) est à remplir en ligne avant le 29 novembre 2024 à l’adresse : https://lstu.fr/inscription-rts-2025
Les projets devront y être décrits, de façon aussi détaillée que possible. Les autorisations de droit à l’image des élèves devront être complétées et conservées par les professeurs responsables du projet.
Les candidats ont également la possibilité de présenter leur travail à d’autres concours, nationaux ou académiques.
• Article 5 • CONCOURS FINANCIER DU DÉPARTEMENT
L’inscription à ce concours est totalement gratuite.
L’acceptation de la fiche de candidature par le comité d’organisation donne droit à une subvention maximum de 200 € par établissement accordée par le Département de l’Yonne (sous réserve de la fourniture du rapport de suivi de projet en avril 2025).
Au-delà de 2 projets proposés, une subvention complémentaire pourra être accordée par le comité de pilotage après étude de la fiche de candidature.
Cette subvention sera utilisée pour aider à financer l’achat de matériel nécessaire à la réalisation technique.
• Article 6 • SÉLECTION ET PRIX
Durant la réalisation du projet, le responsable doit transmettre au comité d’organisation un rapport de suivi de projet sous format numérique présentant la description du projet et l’explication des expériences avant le 7 avril 2025 à
Le rapport peut être accompagné de photos et / ou de vidéos. Vous avez la possibilité d’utiliser l’application do•doc avec vos élèves pour réaliser ce rapport.
Le comité composé de représentants des structures organisatrices sélectionnera, dans la limite de 10, les projets pour la phase finale du concours.
Lors de cette sélection, il sera tenu compte de la qualité du projet et de sa réalisation, à travers les critères suivants :
• implication des élèves,
• pertinence du projet en fonction du ou des thèmes des programmes choisis,
• qualité de réalisation : fonctionnement de la production,
• arguments développés lors de l’exposé,
• originalité du projet.
Les équipes finalistes seront invitées à présenter leur projet devant le jury. La présentation des réalisations sera faite par les élèves sans intervention de leur enseignant. Le Département prendra en charge les frais de transport des élèves ainsi que des accompagnateurs. Toutes les équipes participantes seront récompensées.
Les lauréats, pour chacun des défis, se verront remettre un prix en présence du Président du Département de l’Yonne, de l’Inspecteur d’Académie ou de leur représentant, d’une personnalité scientifique et de la presse.
• Article 7 • CALENDRIER DU CONCOURS
> 01 : OCTOBRE 2024 > Appel à candidature et lancement du concours dans les établissements
> 02 : 29 NOVEMBRE 2024 > Date limite d’inscription en ligne
> 03 : 7 AVRIL 2025 > Date limite de réception du rapport de suivi de projet par le comité d’organisation
> 04 : 6 MAI 2025 > Finale départementale et présentation des projets
> 05 : 17 JUIN 2025 > Sorties des lauréats
La fiche de candidature est à remplir en ligne avant le 29 novembre 2024 sur : https://lstu.fr/inscription-rts-2025
Le dossier de présentation du concours est intégralement téléchargeable sur :
• https://culture-scientifique89.cir.ac-dijon.fr/ – DSDEN de l’Yonne • www.yonne.fr – Département de l’Yonne
Le comité d’organisation :
• Département de l’Yonne – Direction de l’éducation et de la jeunesse – Direction de la promotion et de la communication
• Atelier Canopé de l’Yonne –
• DSDEN de l’Yonne – Bruno Hennoque, conseiller pédagogique sciences –
• Professeur coordonnateur, Florian Robinet –
• Professeur de sciences physiques, Vincent Devaux